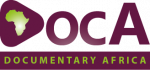INTRODUCTION
Le terme PALOP désigne les pays africains de langue officielle portugaise et regroupe les cinq anciennes colonies portugaises d’Afrique – Angola, Mozambique, Cap-Vert, Guinée Bissau et Sao Tomé – qui ont obtenu leur indépendance entre 1973 et 1975, faisant ainsi par- tie des dix plus jeunes pays d’Afrique.
L’organisation PALOP a été fondée en 2004 sur l’initiative du Cap-Vert, invitant les quatre autres pays africains inclus dans la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP) créée huit ans auparavant sur l’initiative du Portugal.
Le groupe des PALOP partage une forte identité linguistique et culturelle, une histoire politique et économique assez similaire et une longue tradition d’échanges entre eux. Ils ont un passé colonial com- mun, celui d’une colonisation portugaise de militaires, missionnaires et de petits fonctionnaires, de petits colons exclus de la création de richesses réservées aux compagnies étrangères ; des colonies où seule une très faible élite d’assimilados a pu émerger et accéder à des emplois subalternes dans des professions bureaucra- tiques et rarement directement productives ; des élites qui ont finalement pris les armes contre le colonial- isme alors que la plupart des autres pays d’Afrique étaient indépendants depuis la décennie précédente. Ces élites ont imaginé un pays à leur image : moderne, cosmopolite, au rôle économique et social central, avec la langue portugaise comme langue officielle, et mis en place des régimes socialistes auxquels les habitants devaient s’identifier immédiatement. Malgré, bien sûr, de grandes nuances nationales, accrues au fil du temps, les PALOP ont été marqués par des Etats forts, au parti unique, et une idéologie marxiste-léniniste com- mune qui a cédé la place à des politiques économiques libérales dans la deuxième moitié des années 80, puis dans les années 90, au pluralisme politique.
Cette évolution politico-économique a sans aucun doute conditionné le cinéma. Placé au centre des préoc- cupations des partis de libération qui le considéraient comme un instrument de communication de masse pour asseoir les principes des nouvelles Nations, il a été largement pris en charge par les Etats, sur les modèles soviétique et Cubain. Dans le cadre d’un secteur large- ment institutionnalisé, organisé et public, le documen- taire – le genre privilégié par les Etats marxistes – a connu dans chaque pays une sorte d’âge d’or dans les premières années des indépendances. Il a connu aussi son déclin dès la décennie suivante : la libéralisation des économies a mis le cinéma aux mains du secteur privé sans que l’Etat offre les garanties nécessaires pour son développement. Ils ont – comme la grande majorité des pays africains – appliqué les programmes d’ajustement structurel (SAP) proposés par le FMI qui excluaient tout budget public réservé à la culture, entraînant la fermeture progressive des salles de cinémas et la forte baisse ou la disparition de la production.
Outre les disparités nationales qui nous amènent à étudier le secteur cinématographique de chaque pays séparément – nous nous centrerons principalement sur trois pays PALOP, le Cap-Vert, l’Angola et le Mozam- bique, la production documentaire de Guinée-Bissau et de Sao Tomé étant quasiment inexistante – les PALOP semblent témoigner depuis la fin des années 2000 d’un nouveau souffle qui s’incarne dans une jeune généra- tion dynamique et prête à surmonter les obstacles à la production cinématographique.
Les Etats montrent petit à petit un certain intérêt à doter le secteur d’un cadre institutionnel, juridique et légal et à soutenir – ne serait-ce qu’en apparence – ce dynamisme. Avant d’aborder les initiatives dans le domaine du documentaire destiné à l’ensemble des pays d’Afrique lusophone, nous évoquerons brièvement l’état du documentaire en Guinée et Sao Tomé, sans que celui-ci face l’objet d’un chapitre à part eu égard à l’extrême faiblesse du secteur dans ces deux pays.
A partir de nos connaissances du secteur ciné- matographique africain, de nos recherches, des rap- ports officiels parfois disponibles, d’articles de presse et d’interviews avec des professionnels liés au secteur en Afrique lusophone, nous proposons une étude non ex-haustive mais approfondie des dynamiques et des chal- lenges de chaque pays et du groupe des PALOP. Cette recherche sera conduite de façon à envisager la façon dont les institutions et les individus gèrent actuellement l’accès à l’investissement, les changements politiques et les conditions du marché, et les perspectives d’avenir. Nous conclurons en envisageant de possibles solutions dans les volets prioritaires. Le manque d’informations disponibles – en particulier de statistiques malheu- reusement jamais établies de manière systématique par les organisations nationales responsables – nous oblige à mener cette recherche de façon empirique et davan- tage qualitative que quantitative.
CONTEXTE
Géographique et démographique
L’Angola est le pays le plus étendu de l’Afrique au sud du Sahara, après la République Démocratique du Congo, avec une superficie de 1 246 700 km2. Peuplé d’environ 18 millions d’habitants, il est composé de 18 provinces, majoritairement rurales, celles situées au sud, à la frontière namibienne, étant même désertiques. Les zones urbaines sont principalement situées sur la côte, à commencer par la capitale Luanda d’environ cinq mil- lions d’habitants et les villes de la province de Benguela : Lobito et Benguela. Huambo fait figure d’exception, située au centre du pays. Ces trois villes sont peuplées de moins de 300 000 habitants. Ces réalités géographiques et démographiques sont évidemment déterminantes pour le développement du septième art, secteur urbain par excellence : les activités cinématographiques sont presque exclusivement concentrées sur Luanda. En re- vanche, l’Angola possède de grandes richesses naturelles (pétrole, gaz, hydroélectricité, mines, diamants, agri- culture, pêche, eau), qui font de lui un pays au potentiel énorme sur le plan économique.
Economique
L’économie angolaise, extrêmement affaiblie par les 27 années de guerre civile dont le pays a souffert, a connu une croissance très rapide entre 2002 et 2008. Après une contraction en 2009-2010, effet de la crise économique mondiale, la relance est effective depuis 2011 sous les influences conjuguées de la forte hausse du prix du baril, du démarrage des exportations de gaz et de la relance des investissements publics. A tel point qu’il pourrait devenir en 2020 la 5ème puissance économique d’Afrique derrière l’Afrique du Sud, le Nigéria, l’Egypte et l’Algérie. Son PIB actuel dépasse les 99 milliards de dollars annuels.
Mais la croissance de l’Angola est largement tribu- taire du secteur pétrolier (40% de son PIB et 96% des exportations), insuffisamment lié à l’économie réelle du pays, employant seulement 1% de la population active. A l’inverse, le secteur primaire qui rapporte seulement 8% des richesses nationales, emploie plus de 85% de la population active.
L’économie angolaise reste donc une économie pauvre et aux structures peu avancées. Le revenu par habitants, même s’il a quintuplé depuis 2004, reste faible (8 par jour) et l’IDH est de 0,486. La moitié de la popula- tion angolaise est au chômage ou sous-employée et la fracture entre pauvres et riches ne cesse d’augmenter. Les avancées constantes de l’Angola sur le plan social depuis 2002 – les dépenses sociales représentaient en 2011 30% du budget de l’Etat – se heurtent à des dif- ficultés colossales pour faire reculer le chômage et la pauvreté. L’espérance de vie est encore très faible et le système éducatif est très insuffisant.
L’Angola est probablement, au vue de son potentiel et de sa croissance économiques, le pays des PALOP po- tentiellement le plus à même de développer une indust- rie cinématographique. Pourtant, au-delà des difficultés pour renforcer le développement humain, la situation politique de l’Angola représente un autre obstacle au développement du cinéma en Angola.
Politique
Après la révision constitutionnelle de 1992, la Répub- lique Populaire d’Angola – régime marxiste léniniste à parti unique – est une république à régime présidentiel multipartite. Cependant, ce multipartisme est assez superficiel. La constitution de 1992 prévoyait l’élection du Président au suffrage universel direct pour cinq ans, ce qui n’a jamais été appliqué. La révision constitution- nelle de 2010 a changé ce mode électoral : la tête de liste du parti remportant l’élection générale est automa- tiquement président, le second devenant vice-président.
Le régime offre au président des pouvoirs énormes –le président actuel étant en outre au pouvoir depuis 33 ans. Il est le chef de l’Etat mais aussi le chef du Gouverne- ment, contrôlant non seulement l’exécutif mais aussi le législatif et le judiciaire. Le législatif est en théorie partagé entre le gouvernement et l’Assemblée Natio- nale. Cette dernière, chargée de voter les lois, consentir l’impôt et contrôler les activités du gouvernement, a en pratique un champ d’action très limité : le président étant tête de liste et leader de son parti, il incarne le chef de la majorité et est la source originelle de la majorité des lois. Dans ce système multipartite l’opposition a un pouvoir minime, et l’indice de démocratie de 3,32 place l’Angola parmi les régimes autoritaires.
Par ailleurs, le président nomme les directeurs des prin- cipales institutions publiques et juridiques, et contrôle les institutions et entreprises clés du pays. Hormis SONANGOL (pétrole) et ENDIAMA (diamant), il contrôle également les médias : la Télévision Publique d’Angola, monopolistique à l’exception de la télévision privée TV Zimbo gérée par sa fille, la Radio Natio- nale d’Angola, la seule radio à couverture nationale et l’unique quotidien, Jornal de Angola, situation forte de sens quant à la véritable liberté d’expression dans le pays.
Dans ce contexte politique, le développement d’un cinéma documentaire – cinéma libre et critique par excellence – résulte difficile.
Cinématographique
Comme dans les autres pays africains lusophones, le cinéma a été considéré comme un important instru- ment de mobilisation idéologique et de communication d’idées au public lors de la lutte de l’Indépendance et dans les premières années de la nouvelle nation. Dès les premiers temps de l’Indépendance, l’Etat fort s’est impliqué très largement dans l’organisation du secteur cinématographique.
En 1976 la nouvelle République Populaire d’Angola inaugure la Télévision Populaire d’Angola, puis en mars 1977 est créé l’IAC (Institut Angolais du Cinéma) et enfin l’année suivante le LNC (Laboratoire National de Cinéma), institutions surgies de la confiscation et de la nationalisation des structures de production de l’époque coloniale, Cinangola, Promocine et Telecine. L’IAC est en charge de la mise en place des politiques à suivre du cinéma angolais alors que le LNC se charge de la production, en particulier de documentaires et du journal d’actualités filmé présentés dans toutes les salles de cinéma du pays. Naît donc à la fin des années 70 une tradition du documentaire qui atteint une grande qual- ité avec les films d’Antonio Ole, des frères Henriques et surtout de Rui Duarte de Carvalho qui confèrent au cinéma angolais une reconnaissance internationale. En 1981 est créée la Cinémathèque d’Angola, rapidement membre de la FIAF. Durant cette période, le cinéma est entièrement subventionné par l’Etat avec des inves- tissements et des objectifs dirigés : transmettre sa vision de la nouvelle nation aux masses.
Cette période de faste est pourtant brève. Dès 1982 on assiste à un grand recul de la production et seules quelques œuvres des cinéastes de la décennie précé- dente voient le jour. Avec le développement de la télévision, la crise économique et la guerre civile, l’Etat se désengage rapidement du secteur au profit de la télévision, plus économique que le cinéma. Le manque de moyens démotive la nouvelle génération de cinéastes et poussent les anciens vers d’autres arts. Les institu- tions mises en place après l’Indépendance disparaissent peu à peu ou voient leurs activités réduites à néant. Par conséquent, la production devient presque inexistante.
Les années 90 marquent une nouvelle étape : dans le cadre de la politique des alliances définie par le gou- vernement, l’Etat décide d’abandonner la distribution et l’exploitation à l’entreprise privée EDECINE qui convertit les salles de cinéma en salles de cabarets plus rentables. Par ailleurs, les investissements des compag- nies privées – craignant de ne jamais les récupérer – dans la production sont quasiment nulles.
Le bilan est qu’à la fin de la guerre civile, en 2002, le secteur cinématographique est dans une situation extrêmement critique. Pour un nouvel essor du cinéma angolais, l’implication de l’Etat dans les mécanismes de financement et la restructuration institutionnelle et juridique est nécessaire. Depuis 2002, il évolue lente- ment dans ce sens.
POLITIQUE NATIONALE ACTUELLE DE SOUTIEN AU CINEMA
En 2003, le gouvernement inaugure le nouvel Institut Angolais du Cinéma, de l’Audiovisuel et du Multimédia (IACAM), destiné à promouvoir le secteur à tous les niveaux et à coordonner son développement, créant ainsi un nouveau cadre institutionnel. Si le soutien financier de l’IACAM est encore limité aujourd’hui, un effort vient d’être réalisé pour doter le secteur d’un cadre juridique, avec l’approbation le 30 novembre 2011 de la proposi- tion de loi du cinéma et de l’audiovisuel. L’initiative a été motivée en autre par les changements politiques survenus dans la société angolaise et par l’évolution des condi- tionnements propres aux relations internationales, en par- ticulier avec l’Union Africaine, la SADC (Communauté des Pays d’Afrique Australe), la CPLP (Communauté des Pays de Langue Portugaise) et l’Union Européenne / ACP, et par l’innovation technologique.
La loi prévoit donc, outre de réguler le secteur ci- nématographique, de protéger les activités ciné- matographiques et audiovisuelles, et de donner au secteur un cadre juridique indispensable à l’essor de la production, la distribution et l’exploitation ciné- matographiques, de faciliter l’obtention de fonds de coproduction qui exigent l’accomplissement de cer-taines normes. Elle est également destinée à faciliter le développement de l’entreprise dans les domaines ciné- matographique et audiovisuel grâce à la mise en place de mécanismes fiscaux et financiers au bénéfice des entre- prises soutenant le secteur. Le dernier point fondamental est le développement de l’enseignement et des études, des formations professionnelles et de la recherche dans le cadre des activités cinématographiques et audiovisuelles et l’encouragement à des relations institutionnelles et intersectorielles entre les organismes de l’audiovisuel et ceux de l’éducation, de la communication sociale, de l’enseignement supérieur et des sciences et des technolo- gies. Les intentions du gouvernement dans le secteur de la formation visent non seulement l’organisation de formation de professionnels à travers d’ateliers et forma- tions ponctuelles, mais aussi l’introduction de cursus liés à l’audiovisuel dans le système universitaire. Enfin, la loi prévoit l’investissement de l’Etat dans la restauration, la conservation et la valorisation du patrimoine ciné- matographique et audiovisuel.
La création de l’IACAM et l’approbation de la loi du cinéma et de l’audiovisuel prouvent les efforts réalisés pour donner un cadre institutionnel et juridique au secteur. Il faudra maintenant attendre les prochaines années pour voir si sont réellement mis en place des mécanismes financiers qui permettraient à la nouvelle génération de cinéastes de produire dans des conditions décentes des films qui arrivent au public angolais, et au secteur privé de s’impliquer réellement dans ce secteur.
Le gouvernement à travers de l’IACAM a pris égale- ment certaines mesures en ce qui concerne la diffusion, en créant en 2008, le Festival International de Cinéma de Luanda (FIC). Le festival, sur lequel nous revien- drons ultérieurement, cherche à promouvoir le cinéma angolais non seulement par la diffusion des dernières œuvres nationales à chaque édition, mais aussi en ser- vant de cadre à des formations courtes et à des journées professionnelles destinées à stimuler l’industrie ciné- matographique. Par ailleurs, une partie de la program- mation du FIC est rediffusée dans les provinces de Benguela et de Huila, dans un souci de décentraliser les activités de diffusion cinématographique.
Enfin, Pedro Ramalhoso, directeur de l’IACAM, men- tionne dans un article de Jornal de Angola daté du 15 avril 20121 un projet de création d’un centre de produc- tion cinématographique spécialisé en documentaires, sur lequel nous reviendrons ultérieurement.
Cette série de mesures prises par les autorités publiques montre donc une volonté politique évidente d’essor du secteur cinématographique, voire de création d’un véritable marché national de l’audiovisuel et du cinéma. En revanche, cette politique ne semble pas, au contraire du Cap-Vert par exemple, chercher à privilégier la pro- duction documentaire, production généralement plus économique que celle de la fiction.
LE DOCUMENTAIRE ANGOLA
Production
En Angola, le gouvernement et les professionnels du cinéma ne semblent pas chercher à renouer avec la tradition documentaire des premières années de l’Indépendance. La nouvelle génération de cinéastes est en général plus attirée, à quelques exceptions près, par la fiction ou la série télévisée que par le documentaire.
La production sporadique, donc, compte moins d’une dizaine de longs métrages réalisée lors des six dernières années. On citera :
- OXALA CRESÇAM OS PITANGAS, Kiluanje Liberdade et Ondjaki, 2006
- RAP DO QUINTAL, Mário Bastos, 2007
- TCHIOLI, MASSAS E MITOS, Kiluanje Liberdade et Ines Gonçalves, 2009
- LUANDA, A FABRICA DA MÚSICA, Kiluanje Liberdade et Ines Gonçalves, 2009
- VIAGEM AO KUROCA, Nguxi dos Santos, 2010
- NO TRILHOS CULTURAIS DE ANGOLA CONTEMPORÂNEA, Dias Junior, 2010
Ces films ont tous été réalisés par des cinéastes angolais de la nouvelle génération – appelée la Seconde Généra- tion – et trois sont des productions ou coproductions angolaises.2 Ainsi, quelques jeunes noms se démarquent dans le panorama du documentaire angolais, marqués par une grande détermination et une volonté de faire des films malgré les faibles ressources disponibles.
La figure de proue de ce petit groupe d’indépendants est sans aucun doute Kiluanje Liberdade, impliqué exclusivement dans la réalisation de documentaires. Il est l’un des rares cinéastes angolais actuels à avoir une esthétique et un style propres, suivi de près par le prometteur Sergio Afonso, photographe d’origine récemment formé en cinéma et décidé à se lancer dans la réalisation documentaire. Mário Bastos quant à lui mêle les genres et son travail est axé sur la musique angolaise, le rap en particulier. Ces jeunes cinéastes, tous décidés à créer et donner une nouvelle image de l’Angola au reste du monde et à participer au dével- oppement du secteur, représentent un terreau humain nécessaire à la dynamisation du secteur.
Par ailleurs, quelques sociétés privées de production ont vu le jour et commencé à participer dans des coproduc- tions internationales. C’est le cas de Nguxi de Santos, dont la société Dread Locks a coproduit le film de la portugaise Dulce Fernandes, CARTA DE ANGOLA (2011). La devise de la dynamique société Geraçao 80, résume assez bien l’esprit de cette Seconde Génération : « le monde est en crise, l’argent est de plus en plus difficile d’accès pour certains, et la technologie de plus en plus accessible à tous »3, et témoigne de ce nouveau dynamisme et de cette nécessité de faire avancer la création audiovisuelle en Angola.
La Télévision Populaire Angolaise a participé égale- ment à la production de quelques films réalisés en Angola, comme ceux du Portugais Jorge Antonio sur la musique traditionnelle angolaise. Elle a aussi fait partie du programme Doc-TV CPLP sur lequel nous revien- drons dans un prochain chapitre. Mais de manière gé- nérale, son implication dans la production audiovisuelle nationale reste très ponctuelle et quasi inexistante.
Comme évoqué précédemment, l’IACAM a l’intention de créer prochainement un centre de production ciné- matographique . Cependant, la décision du gouvernement est très orientée : il s’agit d’encourager la production de documentaires illustrant les manifestations culturelles et la croissance des villes, notamment de Luanda.
Déjà en 2010, lors des secondes Rencontres de Créa- tions Audiovisuelles organisées à Luanda, la minis- tre de la culture, Rosa Cruz e Silva, avait témoigné de l’importance de produire des documentaires qui « révèlent de manière artistique les actions du gou- vernement et les paysages naturels du pays, princi- palement les zones inexplorées du point de vue ciné- matographique »4. Même si Ramalhoso précise qu’il s’agit également de créer de l’emploi pour les jeunes récemment formés en audiovisuel, l’objectif est clair. Les démarches du gouvernement tendent vers le con- trôle de la production, vers l’essor d’un documentaire de propagande plutôt que d’un documentaire de créa- tion libre et indépendant.
Diffusion
L’évolution des réseaux de salles angolais ne fait pas figure d’exception dans le panorama de l’exploitation cinématographique africain. Si dans les années 1990, les salles – concentrées presque exclusivement à Lu- anda – étaient au nombre de treize, il n’en reste plus que deux en activité actuellement : le Cinema Atlântico et le Corimba, auquel s’ajoute le complexe de salles Cineplace Belas Shopping inauguré en mars 2007 et qui propose à sa clientèle une programmation de blockbuster hollywoodiens et de films commerciaux internationaux. Le ministère de la culture et l’entreprise Endecine ont annoncé un plan de récupération et de modernisation des anciennes salles de Luanda et de re- vitalisation de la distribution qui nécessite le soutien de la société civile et du secteur cinéma. Son impact sera effectif seulement s’il est accompagné d’une revalorisa- tion du cinéma comme activité culturelle et de loisir et dans le cadre d’un développement humain général.
L’IACAM a créé en 2008 le Festival International de Cinéma de Luanda qui représente actuellement la plus grande opportunité pour les documentaristes angolais (et cinéastes en général) de montrer leurs œuvres dans le pays. Bien qu’il soit international, la programmation réserve une grande place aux cinémas africains actuels et en particu- lier aux films des pays africains lusophones. En 2011, le FIC Luanda présentait trois documentaires angolais (deux courts et un long métrage) et trois documentaires mozambicains en compétition. La direction artistique est d’ailleurs assurée par deux cinéastes de la Seconde Génération, Nguxi dos Santos et Dias Junior. Quant à la direction générale, elle est assurée par le directeur de l’IACAM en personne, Pedro Ramalhoso. Encore une fois, n’existant pas d’autres festivals à l’échelle nationale, cette situation confère à l’Etat un contrôle en solitaire et à tous les niveaux du secteur cinématographique.
Le FIC Luanda représente ainsi la plateforme prin- cipale de rencontres de cinéastes en Angola. Des rencontres professionnelles sont organisées chaque année, invitant des acteurs de l’audiovisuel interna- tional et en particulier de la Communauté de Pays de Langue Portugaise (CPLP), des PALOP et du secteur cinématographique africain en général, dans l’objectif d’échanger sur les différentes stratégies de développe-ment du secteur. Le FIC propose également des ateliers de formation.
L’une des missions de la Télévision Publique Ango- laise consiste à « promouvoir la production nationale de matériel télévisuel et autre audiovisuel, en particu- lier d’auteurs qualifiés dans les domaines de la fiction angolaise et du documentaire ».5 Pourtant, au vu de sa programmation, l’espace réservé à la diffusion de documentaires nationaux ou d’autres pays africains lusophones est très réduite. Les « documentaires » dif- fusés sont principalement des reportages TV, les deux chaînes consacrant également un large temps d’antenne au parti politique au pouvoir. Les programmes de la TPA dépendant directement du gouvernement sont principalement des programmes de propagande qui font l’éloge des actions de ce dernier.
Formation
La formation représente un volet prioritaire pour l’IACAM. Cependant jusqu’à maintenant, seulement quelques menues initiatives ont été mises en place dans ce sens, bien qu’elles soient très insuffisantes. C’est d’ailleurs pourquoi les documentaristes de la Sec-onde Génération se sont formés à l’étranger: Kiluanje Liberdade au Portugal, Mário Bástos aux Etats-Unis et Sergio Afonso au Brésil.
Le festival de Luanda organise chaque année un atelier dont l’objectif est la réalisation d’un court métrage par les participants pendant le festival. En 2009, un atelier de production a été également organisé dans le cadre du FIC Luanda par l’Institut Camoes, en partie pour combler le vide existant en matière de formation en Angola. Animé par le Portugais Marcos Pimentel, il vi- sait la création d’un réseau de coopération audiovisuelle entre les producteurs de langue portugaise, en plus d’offrir une formation aux jeunes réalisateurs d’Angola, Mozambique, Portugal, Brésil et Cap-Vert qui leur permettrait de perfectionner leurs projets en cours.
Par ailleurs, le ministère de la culture a organisé les rencontres de Création audiovisuelle en collaboration avec l’Alliance Française de Luanda. Deux éditions ont eu lieu jusqu’à aujourd’hui, animées par des spécialistes étrangers du secteur de la production et la distribu- tion et chargés d’orienter les réalisateurs sélection- nés à élaborer des projets capables d’attirer des fonds d’institutions étrangères.
L’objectif actuel du ministère de la culture en terme de formation est de constituer un groupe de cinéastes dont la production soit compétitive à l’échelle internationale. Il s’agit donc non seulement de formation continue pour les professionnels nécessitant compléter leurs connais- sances, mais aussi d’intégrer des cursus spécifiques de cinéma et audiovisuel dans les universités. Dans ce sens, le ministère de la culture élabore en ce moment un projet d’Ecole des arts dont le cinéma serait une des filières.
Quoiqu’il en soit, à l’heure actuelle, le secteur de la formation est à l’état embryonnaire et les formations ne sont que très ponctuelles et jamais orientées sur le documentaire en particulier. En revanche, il est évident qu’il représente l’étape primaire et fondamentale pour un possible développement du secteur.
CONTEXTE
Géographique
Le Cap-Vert est un archipel composé de deux séri- es d’îles: les îles de Sotavento au Sud (Brava, Fogo, Santiago, Maio) incluant la capitale du pays, Praia, sur l’île de Santiago, et les îles de Barlavento au Nord (Boa Vista, Sal, São Nicolau, Santa Luzia, São Vicente et São Antão) incluant Mindelo, la deuxième plus grande ville du pays, sur l’île de São Vicente.
Cette situation géographique isolée – le pays se trouve à 500 km du continent – et fragmentée représente un premier handicap : les liaisons aériennes, malgré quatre aéroports internationaux récemment rénovés, ne sont que de médiocre qualité, avec seulement un ou deux vols desservant la capitale Praia de Mindelo, aux horai- res peu respectés et parfois annulés, et aux coûts assez élevés (de 40 à 130 par trajet) par rapport au salaire moyen des Capverdiens (175 environ). Les transports maritimes sont, quant à eux, plus longs et plus chao- tiques encore.
Démographique
Le Cap-Vert est par ailleurs faiblement peuplé ; 500 000 habitants se répartissent sur neuf de ses îles, dont 60% représentent une population rurale. La grande majorité des résidents urbains sont établis à Praia ou à Mindelo. En outre, on compte beaucoup plus de Capverdiens dans la diaspora que dans leur propre pays.
Economique
Bien que l’IDH ( Indice de développement humain) du Cap-Vert (0,568) soit le plus élevé des PALOP et qualifié de moyen par le PNUD, le Cap-Vert est encore considéré comme un pays en voie de développement. Cependant, la croissance économique du pays est en progrès depuis la fin des années 2000 et le Cap-Vert a quitté en 2007 le groupe des PMA (Pays les Moins Avancés).
L’économie capverdienne est majoritairement tournée vers les services de commerce, de transports, tourisme et services publics qui représentent 80% du PIB. Au
cours des cinq dernières années ont été mises en place des réformes économiques destinées à stimuler le secteur privé et attirer des capitaux étrangers.
Le gouvernement, pour soutenir cet essor, a mis en place un vaste programme d’infrastructures dans les domaines de premières nécessités (santé, transports, communications). Cependant, cette croissance est principalement le résultat de l’aide internationale qui comble en grande partie le grand déficit commercial annuel. L’avenir économique du pays dépendra beau- coup du maintien des flux de l’aide.
Culturel et cinématographique
Le contexte général du pays, même s’il présente une certaine avancée, n’est pas encore propice au développe- ment immédiat de la production cinématographique. Les priorités du gouvernement ne semblent pas se concentrer sur la culture.
Au moment de l’indépendance, comme dans le reste des PALOP, le cinéma a été soutenu par les thèses des leaders de mouvements de libération, principalement par celles d’Amilcar Cabral dans le cas du Cap-Vert. Le cinéma était perçu comme un support médiatique fondamental de la lutte et de l’indépendance.
En 1960, un premier ciné-club capverdien a vu le jour à Praia, presque aussitôt interdit par la PIDE (police politique portugaise). Il est de nouveau actif en 1975, soutenu par le PAIGC. Le ciné-club programme des films des cinés-clubs de Lisbonne et prend en charge le tournage des premières élections et autres activités liées à l’avènement de la nouvelle république du pays. L’Institut Capverdien du Cinéma est aussi créé pour encourager la production documentaire.
Cependant après la première décennie de l’indépendance, la responsabilité étatique envers le secteur cinématographique s’affaiblit largement. La partition du PAIGC qui donne naissance au PAICV au Cap-Vert et l’avènement d’un gouvernement conserva- teur en 1990 motivent la privatisation du secteur et la primauté de la géographie sur la lusophonie. Les liens s’étant distendus avec le reste des PALOP, le secteur cinématographique considéré jusque-là dans l’ensemble de l’espace lusophone, est désormais conçu dans une perspective nationale.
POLITIQUE NATIONALE DE SOUTIEN AU CINEMA
L’absence de mesures publiques concrètes est probable- ment le principal obstacle au développement du secteur.
Les gouvernements successifs des dernières décennies ont promis certaines réformes qui semblent ne pas avoir été tenues. Le Gouvernement de la VII législature (2001-2005) a par exemple proposé un plan stratégique de développement du secteur rappelant et annonçant :
- la création d’un organisme lié au Ministère de la Culture pour la promotion de la création audiovisuelle et multimédia
- la nécessité des investissements
- l’adoption d’un modèle organisationnel mieux adapté aux nécessités du pays
- l’optimisation de nouveaux marchés
- la contribution du gouvernement pour la formation de producteurs, de réalisateurs et pour la création d’espaces de production et de diffusion, pour la stimulation d’initiatives
- la mise en place d’une nouvelle législation
- la protection de la propriété intellectuelle
- Selon la majorité des professionnels du secteur, ce plan n’a pas été appliqué.
En 2011, le nouveau Ministre de la Culture Mário Lúcio Sousa a annoncé un certain nombre de mesures qui suscitent l’espoir chez certains professionnels et le scepticisme chez d’autres.
Un nouveau « Núcleo Cinemedia da Direcção Nacional das Artes », pôle audiovisuel rattaché au ministère de la Culture a été créé au début de l’année 2012. Bien qu’il soit encore tôt pour en juger l’efficacité, on lui reproche déjà un manque de dialogue avec les professionnels. Sa présence a été nulle dans le processus de création récent d’une associa- tion du cinéma et de l’audiovisuel inaugurée en mars 2012 – et sur laquelle nous reviendrons ultérieurement – aussi bien sur le plan opérationnel que professionnel.
Le Plan Stratégique Intersectoriel de la Culture (PLEI) du nouveau gouvernement ne mentionne que briève- ment le secteur cinématographique et audiovisuel, et sous les termes suivants : « promouvoir la production nationale et principalement de documentaires et de fictions en partenariat avec les compagnies de théâtre », témoignant ainsi un manque de compréhension ou d’intérêt réel envers le milieu.
Enfin a été récemment créée une Banque Culturelle qui semble cependant encore peu efficace et peu adaptée à la réalité du secteur cinématographique. capverdien dans son état actuel, de par la faiblesse de sa production et de sa distribution, et de par l’absence d’un marché réel, peut difficilement être rentable. Le développement du cinéma – documentaire inclus – doit passer par une phase encore subsidiaire.
Les dernières mesures annoncées par le gouvernement concernent la création ou la réhabilitation de salles, disparues au fil du temps comme dans le reste du conti- nent. Deux projets de salles multifonctionnelles (cinéma et autres activités culturelles) ont été annoncés, l’une d’une capacité de 3000 spectateurs à Praia et l’autre de 1500 spectateurs à Mindelo. Le gouvernement a d’ores et déjà signé des accords avec des partenaires privés pour la construction de la première mais cherchent encore des bailleurs de fonds privés pour la seconde.
ETAT DU DOCUMENTAIRE CAPVERDIEN
Production quasiment inexistante
La production/réalisation de films documentaires au Cap-Vert est encore très limitée et concentrée entre les mains de quelques réalisateurs résidant au Cap-Vert, principalement Leão Lopes et Júlio Silvão Tavares.
Lors des dix dernières années ont été réalisés quatre longs métrages documentaires :
- BITÚ de Leão Lopes, 2005, 50’
- BATUQUE A ALMA DE UM POVO, Júlio Silvão Tavares, 2006, 52’
- EUGÉNIO TAVARES, CORAÇÃO CRIOULO, Júlio Silvão Tavares, 2009, 52’
- SÃO TOMÉ E PRINCIPE, MINHA MAE, MINHA TERRA, MINHA MADRASTA, Júlio Silvão Tavares, 2012, 52’
Seul le dernier film est une production capverdienne assumée par le propre réalisateur. Le premier est une production portugaise, le second une coproduction franco-portugaise et le troisième produit dans le cadre du programme Doc TV CPLP sur lequel nous reviendrons dans un autre chapitre. Le dernier, en revanche, a été produit par la société de production du réalisateur.
Il existe certes un certain nombre de films produits par des Capverdiens de la diaspora. On peut citer les longs métrages tournés au Cap-Vert des Américains- Capverdiens Guenny Pires (THE JOURNEY OF CAPE VERDE, 2005 et CONTRACT, 2010) ou Claire Andrade Watkins (OLÀ VIZINHO, 2010) ou encore les long et court métrage de Ana Fernandes, cap- verdienne résidant en Allemagne (REBELADOS, 2010 et GOLFO POPULAR, 2011) et quelques autres encore. Mais tous ces films sont produits par les pays de résidence des réalisateurs sans apport capverdien.
Il est donc difficile devant la rareté des films réalisés et produits au Cap-Vert de parler d’un « cinéma docu- mentaire capverdien ». Selon les propres termes de Júlio Silvão Tavares 6, les obstacles résident principale- ment dans le manque d’engagement de l’Etat quant au soutien du secteur et dans le manque de techniciens, scénaristes et autres professionnels capables d’assumer les phases préparatoires à la production d’un film.
L’accès aux coproductions est par ailleurs rendu diffi- cile par le manque de structures. Les aides à la co- production internationale sont généralement remises à un organisme spécialisé chargé de les redistribuer, or l’Institut Capverdien du Cinéma n’est plus qu’une institution fantôme obsolète.
Selon le réalisateur César Schofield7, l’essor de la production ne peut passer que par un modèle similaire à celui des industries créatives. D’un côté, le Cap-Vert bénéficie d’une population jeune, et un certain dyna- misme et intérêt envers le documentaire, l’audiovisuel, l’art vidéo et le multimédia est notoire à l’heure ac- tuelle. De l’autre, une grande quantité de matériel – caméras légères et ordinateurs – est disponible dans le pays. L’essor du secteur ne peut passer selon Schofield que par une phase d’expérimentation à partir de ce matériel disponible et aux faibles coûts de production, adaptés à la réalisation documentaire.
Diffusion Limitée
Le Cap-Vert comme la majorité des pays d’Afrique a souffert très largement de la fermeture progressive des salles de cinéma, généralement rachetées par des inves- tisseurs du tourisme étrangers ou converties en église. En 2007 le Cap-Vert ne comptait plus une seule salle de cinéma. Aujourd’hui, deux seulement sont en activité.
Le ciné club de Assomada sur l’île de Santiago a été à nouveau inauguré en octobre 2010 sur une initiative privée et avec le soutien de la municipalité. Equipée de ses anciens projecteurs et d’un appareillage numérique basique, la salle est en activité quatre jours sur sept. La programmation est conçue selon des critères de qualité et de diversité, une faible place étant cependant réservée au documentaire. Le prix des billets symbolique et une population apparemment cinéphile permettent une affluence assez importante. Par ailleurs, la salle fait partie depuis avril 2012 du Réseau National de Salles, projet mis en place par le Ministère de la Culture en vue d’établir en partenariat avec les autorités locales un circuit pour la divulgation de la culture capverdienne (musique, danse, théâtre, artisanat, arts plastiques, lit- térature). La multifonctionnalité des salles semble être une condition sine qua non pour leur viabilité.
L’autre salle encore en fonctionnement actuellement au Cap-Vert se situe à Mindelo. Elle propose deux titres par mois et consacre une importante partie de sa programmation aux productions des PALOP.
Néanmoins, la réalité du réseau de salles n’est vraisem- blablement pas une issue pour la diffusion du docu- mentaire. Les solutions à court terme sont à chercher du côté de la télévision. La Radio Télévision Capverdi- enne qui jusque là ne s’est consacrée qu’à la diffusion de documentaires d’origine étrangère, semble déterminée à faire de nouveaux efforts pour la diffusion du docu- mentaire capverdien et de pays africains lusophones.
Les festivals semblent aussi s’attacher à la diffusion d’une production plus locale. Depuis 2008, le Centre Culturel Portugais organise à Praia le festival Maio. Doc, réalisé à partir d’un programme d’extensions et itinérant du festival DocLisboa, en partenariat avec l’association portugaise Apordoc. Le festival ressemble cependant davantage à un cycle de cinéma limité à huit séances, et neuf des dix films présentés lors de l’édition 2012 étaient portugais, le dernier étant le documen- taire de Júlio Sivão Tavares. L’événement organisé par l’Institut Camões est davantage destiné à la promotion du documentaire portugais qu’à celui des PALOP.
Un autre festival qui a vu le jour en 2010 centre en revanche sa programmation sur le cinéma luso-phone. Même s’il n’est pas spécifiquement axé sur le documentaire, le Festival International de Films du Cap-Vert « Viva Imagens », célébré sur l’île de Sal, proposait dans sa dernière édition des documentaires capverdiens, de la diaspora capverdienne et d’Angola. Il proposait également un atelier documentaire animé par la réalisatrice Claire Andrade Watkins. La prochaine édition est prévue pour octobre 2012 et l’événement semble se consolider.
Enfin, le dernier festival actif aujourd’hui est le festival du court métrage « Culturamóvel » à Praia. Il s’inscrit dans un projet plus ample de coopération internationale sur lequel nous reviendrons ultérieurement, destiné à la formation en audiovisuel et à la stimulation du dialogue culturel par le biais des TIC. Les films projetés sont les fruits des ateliers organisés dans le cadre du projet.
Le principal obstacle à la diffusion du documentaire au Cap-Vert reste le même : le manque de soutien insti- tutionnel. Il existe de toute évidence un dynamisme de la part des activistes culturels locaux dont les initia- tives sont caduques par le manque de relais de la part des autorités publiques, mais aussi par le manque de disponibilité de professionnels du secteur et de travail en réseau.
La formation : une série d’initiatives récentes qui nécessitent une continuité
Le même phénomène se reproduit quant à la forma-tion. Une série d’initiatives récentes montrent une rée- lle volonté de dynamiser le secteur cinématographique et audiovisuel dans le pays. Mais ces initiatives restent ponctuelles et inscrites dans un cadre de coopération internationale à durée limitée.
En janvier 2011, sur l’initiative du réalisateur brésilien Joel Zito Araujo et sous la direction pédagogique du même réalisateur et du réalisateur capverdien Leão Lopes, un cours de spécialisation « Lato Sensu » en cinéma et audiovisuel de dix semaines a été organisé au M_EIA (Institut Universitaire d’Art, Technologie et Culture) de Mindelo, dans le cadre d’une collabo- ration entre le Ministère capverdien et la fondation culturelle brésilienne Palmares. Le projet destiné à stimuler l’échange interculturel et économique entre le Brésil et le Cap-Vert et à combler en partie les carences dans le secteur de la formation de professionnels du cinéma et télévision au Cap-Vert, a accueilli un ving- taine d’étudiants en grande majorité du Cap-Vert, mais aussi du Mozambique, du Portugal, du Brésil et du Sénégal, âgés de 26 à 58 ans et majoritairement profes- sionnels de la télévision ou de sociétés de production de vidéo locales. Des intervenants du Brésil, de Cuba et du Cap-Vert ont concentré leurs enseignements sur l’esthétique et l’histoire du cinéma, sur l’écriture de scé- nario, le regard critique, les techniques de production, de réalisation, de montage, son et caméra. L’expérience extrêmement positive selon Joel ZitoAraujo8, a débou- ché sur la production d’un long métrage documentaire, FRAGMENTOS DE MINDELO, qui a participé à divers festivals internationaux et de deux courts mé- trages de fiction. Le projet a été soumis de nouveau à la Fondation Culturelle Palmares en collaboration avec l’Agence Brésilienne de Coopération et du Ministère des Affaires Etrangères dans la perspective de le recon- duire lors du second semestre 2013. Cette seconde édi-tion prévoit une participation de membres d’autres pays PALOP et sera organisée de nouveau en partenariat avec le M_EIA.
« CulturaMóvel » est un projet d’un an destiné à « augmenter la croissance de l’industrie audiovisuelle du Cap-Vert par l’optimisation des nouvelles technolo- gies ». Organisé par les entités capverdiennes « O’Dam ONGD » et « Associaçao Assimboa », co-financé par l’Agence Espagnole de Coopération et de Développe- ment en partenariat avec le Ministère de la Culture capverdien, CulturaMóvel se développe en milieu sco- laire et vise à former les professeurs et les élèves dans la création audiovisuelle. Des ateliers de réalisation à partir de caméras légères, appareils photographiques, téléphones portables ou web cams, ont été organisés avec 990 élèves de 12 à 16 ans. Les courts métrages ré- alisés – pour certains documentaires – ont été présentés au Festival de Courts métrages à Praia. Le projet Cul- tura Móvel est de toute évidence une initiative positive pour la stimulation de l’intérêt porté à l’audiovisuel. Il est nécessaire d’impliquer le milieu scolaire dans la sensibilisation au cinéma. Cependant on ne peut parler ici que d’un projet de sensibilisation et non pas d’un projet de formation. On peut relever quelques autres projets ponctuels de formation comme le cours de trois semaines en produc- tion audiovisuelle organisé à Mindelo par ADECO, l’Association de Défense du Consommateur en 2010. Animée par le journaliste capverdien résidant aux Pays Bas Gui Ramos et ouverte à tous les publics, la forma- tion était centrée sur l’apprentissage du maniement de matériel audiovisuel moderne et de la production d’émissions et de reportages. De nature journalistique plutôt que cinématographique, la formation a cepen- dant été perçue comme positive par son animateur qui souligne un évident potentiel chez les jeunes partici- pants mais déplore un manque de prise en charge sous forme de stages dans des entreprises de communication après la formation.
Ces nouvelles initiatives montrent évidemment une réelle volonté de la part des professionnels. Ce que confirme la création en mars 2012 de l’ACACV, as- sociation du cinéma et de l’audiovisuel au Cap-Vert qui souhaite centrer ses activités en priorité sur la formation. Cependant, pour être réellement efficaces, ces initiatives doivent s’inscrire dans la continuité et la décentralisation. Aucune université capverdienne ne propose un cursus exclusivement consacré à la réali- sation et production de cinéma ou documentaire, la formation universitaire dans ce domaine étant reléguée à de brefs ateliers inclus dans les cursus de journalisme, communication et publicité.
L’histoire du cinéma en Guinée Bissau s’inscrit dans un cadre similaire à celui des autres PALOP : celui d’un Etat révolutionnaire fort à parti unique décidé à prendre en charge l’organisation et le contrôle du secteur à des fins idéologiques et politiques. Les premières productions nationales ont vu le jour dans la seconde moitié des années 70. Il s’agit des courts- métrages documentaires de 1976 : O REGRESSO DE CABRAL (1976) et ANOS NA OÇA LUTTA, coréalisations de Sana Na N’Hada et Flora Gomes, les deux uniques réalisateurs du pays jusqu’à une date très récente. Sana Na N’Hada persiste dans le genre documentaire avec deux autres productions avant de passer à la fiction. Dès les premières années de l’indépendance est créé l’Institut National de Cinéma, qui ne sera jamais doté des moyens nécessaires pour appuyer réellement le développement d’une ciné- matographie nationale. Celle-ci est le résultat du par- cours de combattants de Sana Na N’Hada et surtout de Flora Gomes et ses fictions reconnues à l’échelle internationale. Fermé au milieu des années 80, l’INC a été réactivé en 2003 dans l’objectif de relancer toutes les activités liées au cinéma, à commencer par la réouverture de salles. Cependant la situation politique extrêmement instable en Guinée depuis 98 laisse pour l’instant peu d’espoir quant à la mise en place d’un système organisé du secteur de la part de l’Etat.
La production nationale compte à peine une quinzaine de films, et seulement 4 documentaires ont été réalisés depuis les années 2000 : BISSAU D’ISABEL de Sana N’Hada (2005), la coréalisation de Flora Gomes et de Diana Andriga, AS DUAS FACES DA GUERRA (2007) et ceux de deux nouveaux venus dans le secteur, ZÉ CARLOS SCHWARTZ – A VOZ DO POVO (2005) de Adulai Jamanca et O RIO DA VERDADE (2009) de Domingos Sanca, produit dans le cadre du programme Doc TV CPLP. D’autres jeunes réalisateurs comme Geraldo Manuel de Pina, Suleimane Biai ou Waldir Araújo, ont tenté de développer leurs projets doc- umentaires, présentés aux rencontres Tenk d’Africadoc à Gorée, mais les films n’ont pas abouti pour le moment. Cela témoigne cependant de l’émergence d’une nouvelle génération attirée par le documentaire.
Quant à Sao Tomé, si elle parfois terre d’accueil pour la réalisation de quelques documentaires étrangers et quelques cycles de cinéma des PALOP, sa propre pro- duction est quasiment nulle. On ne citera que le film de Felisberto Branco, TCHILOLI, REALIDADE DE UM POVO (2009) réalisé lui aussi dans le cadre du programme Doc TV CPLP.
CONTEXTE
Géographique et démographique
D’une superficie de plus de 800 000 km2, le Mozam- bique est le second plus grand pays des PALOP. Il est surtout très étiré du Nord au Sud avec un littoral sur l’océan indien de pratiquement 2 500 km. La capitale, Maputo est située à l’extrême sud, pratiquement à la frontière sud-africaine. Composé de onze provinces, celles du sud sont plus développées et plus urbaines que celles du Nord, plus pauvres.
Après d’énormes pertes durant les années de guerre civile (1977-1992), la population actuelle d’une vingtaine de millions d’habitants connaît une crois- sance élevée. C’est de fait une population jeune, dont 50% a moins de vingt ans. La population urbaine représente 30% des habitants, davantage qu’en Angola. Le Mozambique compte quatorze villes de plus de 100 000 habitants et quatre de plus de 400 000. La capitale abrite plus d’un million de personnes. Les noyaux urbains sont plus nombreux et plus homogènes quant à leur taille qu’en Angola. Enfin, malgré la grande concentration urbaine dans le sud où sont situées les deux plus grandes villes du pays (Matola et Maputo), les villes de Beira au centre et Nampula au Nord viennent équilibrer la répartition de ces centres urbains. Cette répartition urbaine sur tout le territoire peut représenter une réalité avantageuse pour un développement ciné- matographique décentralisé.
Economique
Les quinze années de guerre civile ont évidemment rendu difficile l’essor de l’économie mozambicaine. Elle s’est développée après la guerre, à partir de 1992, mais le Mozambique reste actuellement l’un des plus pauvres du monde. Presque la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. La population active de 8,4 millions travaille en grande majorité (88,9%) dans le secteur informel et le revenu moyen d’un mozambicain est d’à peine 1 par jour.
L’économie repose principalement sur l’agriculture. Un actif sur cinq travaille dans le secteur primaire. Depuis les années 2000, elle juxtapose les petites fermes famili- ales et les grandes exploitations agricoles appartenant à des grandes entreprises. La production ne satisfait pas les besoins alimentaires de la population mais certains produits agricoles sont pourtant exportés : le coton, la canne à sucre, le coprah et les noix de cajou. Depuis la décennie précédente, le tourisme et l’industrie minière en plein essor représentent aussi des atouts pour l’économie mozambicaine.
La croissance est depuis les années 2000 en hausse per- manente, d’une moyenne de 7,2% entre 2002 et 2012. L’aide et les investissements internationaux ont permis de faire quelques progrès spectaculaires.
Cependant, suite aux grands projets d’exploitation du sous-sol initiés en 2007, le Mozambique a commencé en 2011 ses premières exportations de charbon qui pourraient marquer un tournant dans l’économie et aid- er à conforter la viabilité budgétaire grâce aux recettes tirées des ressources naturelles. Par ailleurs, après les émeutes de 2010, le gouvernement a mis en place un plan d’action de lutte contre la pauvreté assez ambitieux, prévoyant le renforcement de la production agricole, la promotion des emplois dans les petites et moyennes en- treprises et des investissements dans le développement humain et social, à commencer par les infrastructures.
Néanmoins, l’économie reste contrôlée comme le politique par une petite élite, et par une autre venue d’Afrique du Sud, et dopée par les investissements directs étrangers destinés aux industries extractives. La main d’œuvre est mal formée et le système sec- ondaire et universitaire peu développée. Le manque d’infrastructure, la corruption et la forte prévalence du VIH (ayant réduit l’espérance de vie à 48 ans) sont des freins au développement.
Politique
Le régime politique actuel au Mozambique est un régime présidentialiste dans lequel le président est à la fois, comme en Angola, le chef d’Etat et le chef du gou- vernement. Le régime marxiste léniniste à parti unique du FRELIMO étant épuisé par la guerre civile, le prési- dent Samora Machel entame dès le début des années 80 un programme de réformes politiques et économiques majeures, poursuivies par son successeur Joaquim Chis- sano après sa mort. Ces réformes et les négociations de paix avec la RENAMO ont débouché sur une nouvelle constitution, en vigueur depuis 1990, instaurant une économie de marché et transformant l’Etat en une démocratie multipartite aux élections libres.
Le FRELIMO est cependant toujours au pouvoir après les élections de 1994, de 1999, de 2004 et de 2009. Les partis d’opposition ne jouent pas un vrai rôle démocratique. Le principal, la RENAMO, mène une activité politique quasi inexistante en dehors des périodes électorales et un discours de victimisation plus que de projet politique concret. Le jeune MDM, dont la représentation parlementaire est encore très limitée, a trop de difficultés financières pour avoir une présence effective et permanente sur le terrain. Malgré un système pluripartite, le FRELIMO règne donc jusqu’à maintenant en maître sur l’échiquier politique.
Cinématographique
Le Mozambique est un des pays africains à la plus forte tradition documentaire. Comme dans les autres pays d’Afrique lusophone, le cinéma est né dans le contexte de la lutte de libération. Dès la première année de l’Indépendance, toute l’organisation du cinéma est prise en charge par le FRELIMO, le parti au pouvoir, dans le but d’en faire un support clé pour le projet de construc- tion d’un nouvel Etat socialiste, un « instrument agissant dans l’élimination totale de tous les résidus du colonial- isme, et d’éduquer, mobiliser et organiser le peuple »9.
En 1976 est créé l’Institut National du Cinéma (INC) qui se lance dans la production du célèbre Kuxa Kane- ma : un journal cinématographique de dix minutes sur des thématiques considérées importantes à l’époque : la lutte de libération, l’indépendance et les grands travaux de nationalisation du FRELIMO, et l’exaltation de la culture du Mozambique.
Le projet de cinéma de l’INC attire de nombreux cinéastes et techniciens étrangers, notamment de Cuba, du Brésil, du Canada, des pays d’Europe de l’Est, et d’Angleterre. Le gouvernement avait déjà fait appel à Ruy Guerra, le père du Cinema Novo brésilien, pour participer à la création puis aux activités du centre. Il réalise en 1978 le premier long métrage mozambicain MUEDA, MEMORIA E MASSACRE. Sont égale-ment invités à contribuer au projet de cinéma mozam- bicain Jean Rouch, qui crée à Maputo les célèbres Ate- liers Varan et promeut son cinéma direct, et Jean-Luc Godard, qui propose l’utilisation d’un nouveau support plus économique que la pellicule : la vidéo. Même si son projet de nouvelle télévision mozambicaine peu réaliste fut rejeté par Guerra, Godard, tout comme Rouch, ont marqué l’histoire du cinéma au Mozambique.
En ce qui concerne la diffusion, les salles urbaines sont nationalisées. En outre, le gouvernement met en place un réseau de cinéma mobile dans un souci de démocratisation de l’accès au cinéma, avec l’aide de l’Union Soviétique et de la RDA qui met des véhi- cules à sa disposition. Le cinéma mozambicain et en particulier les épisodes de Kuxa Kanema sont dis- tribués dans tout le pays.
La guerre civile, les difficultés économiques – en 1986, le Mozambique est considéré comme le pays le plus pauvre du monde – et enfin la mort de Samora Machel mettent un terme à cet âge d’or du cinéma mozambic- ain. L’INC fait faillite et cesse de produire. Les salles sont fermées dans les villes et le cinéma mobile cesse ses activités en vue de l’insécurité régnante hors des villes. En 1991, un incendie ravage l’INC et une grande partie de ses équipements disparaissent. Au total, il aura produit 120 films – courts, moyens et longs mé- trages – et 350 épisodes de Kuxa Kanema.
Dans les années 90, certains anciens employés de l’INC décident de créer leurs propres sociétés de production. C’est le cas du producteur Pedro Pimenta et de ses confrères réalisateurs Camilo de Sousa et Licinio Aze- vedo, quasiment les seuls réalisateurs de cette décennie. Ebano Multimedia produit alors la majorité des films de cette période : les documentaires de Azevedo, de Sousa et d’Isabel Noronha.
Cependant une nouvelle génération de jeunes a déjà montré, malgré le manque de moyens, un vif intérêt pour le documentaire. Par ailleurs, l’Etat a dernière- ment témoigné d’un nouvel intérêt en termes de soutien au secteur cinématographique.
POLITIQUE NATIONALE DE SOUTIEN AU CINÉMA
Après une absence quasi totale du secteur ciné- matographique lors des deux dernières décennies, l’Etat semble depuis quelques années faire un nouvel effort concernant le développement du secteur.
Fondé en 2000, l’Institut National de l’Audiovisuel et du Cinéma (INAC) est le prolongement de l’ancien INC et sa mission est d’archiver et de conserver les films réalisés ou produits au Mozambique et de stim- uler le développement de l’industrie cinématographique du pays. Il est doté d’une archive et d’un auditorium pour la diffusion.
Peu actif dans ses premières années, c’est dans le do- maine de la conservation qu’il commence ses activi- tés. En 2008, l’INAC se lance, en collaboration avec l’Institut Portugais de Soutien au Développement (IPAD) et la Cinémathèque Portugaise-Musée du Cinéma, un projet important de restauration du pat- rimoine audiovisuel. Les organismes portugais appor- tent une assistance technique et matérielle et offrent surtout la possibilité à des techniciens mozambicains de se former dans la restauration de films. S’agissant de la toute première étape d’un grand processus de restauration, valorisation et diffusion des films ar- chivés à l’INAC, la formation est le volet fondamental de ce projet, pour assurer sa viabilité dans la durée. Une partie des épisodes de Kuxa Kanema, entre au- tres, ont été restaurés et présentés dans divers festivals internationaux, comme le Doc Lisboa.
Plus récemment, face aux revendications des profes- sionnels, indignés par le manque de coordination du secteur, les taxes de tournage trop élevées, le manque d’information sur la loi du mécénat, et l’absence de contrôle de l’établissement de sociétés de production étrangères au Mozambique, le gouvernement a ac- cepté de donner un cadre juridique et légal au secteur.
A l’issue de diverses réunions entre le Ministre de la culture et des professionnels, un projet de loi destiné à créer une stratégie pour le cinéma national et pour le développement économique des activités de produc- tion, distribution et diffusion des films est à l’étude.
Cependant les efforts à faire pour mettre en place une politique du cinéma solide qui puisse réellement relanc- er le secteur sont énormes, et dans tous les domaines, à commencer par la formation.
ETAT DU DOCUMENTAIRE
Production
Comme signalé précédemment, durant les deux dernières décennies, seuls une poignée de réalisateurs ont signé la totalité des films produits. La principale société de production Ebano Multimédia a permis aux films de Licinio Azevedo, Camilo de Sousa, et Isabel Noronha entre autres, de voir le jour et d’éviter un vide temporel dans la production nationale, documentaire et cinématographique en général. Depuis 2006, trois longs métrages documentaires d’Azevedo (RICARDO RANGEL – FERRO EM BRASA, 2006, HOS- PEDES DA NOITE, 2007 et ILHA DOS ESPIRI-TOS 2010) ont été produits et diffusés à l’échelle internationale. Isabel Noronha quant à elle, a produit quatre longs métrages dans un nouveau genre qui mêle le documentaire et l’animation.
Soulignons ici que de manière générale, à l’inverse de ce qui se produit en Angola ou au Cap-Vert, les cinéastes de la première génération, formés à l’INC, ont eu la possibilité malgré tout de produire et réaliser régulièrement jusqu’à nos jours, ce qui place de nou- veau le Mozambique dans une situation privilégiée dans ce domaine.
Depuis quelques années, et particulièrement depuis la création du festival de cinéma documentaire de Maputo, le Dockanema, en 2006, le dynamisme d’un nouveau petit groupe de jeunes désireux et déterminés, a accru la production documentaire mozambicaine. Des noms comme Joao Ribeiro, Lionel Moulinho, Aldino Languana, ou Diana Manhiça, entre autres, renouvel- lent la liste de documentaristes mozambicains. Ces trois dernières années, une quinzaine de documentaires, entre longs et courts métrages, ont été produits par la nouvelle génération et diffusés dans diverses manifesta- tions culturelles locales.
Par ailleurs, le Mozambique est aussi une terre d’accueil de nombreux documentaires étrangers, une dizaine depuis 2009. Certains d’entre eux ont bénéficié d’un statut de coproduction nationale, notamment ceux réalisés par des cinéastes étrangers résidant ponctuel- lement au Mozambique. D’autres ont pu bénéficié du soutien logistique d’un réseau de professionnels locaux.
Si la qualité n’est pas toujours d’un excellent niveau – souvent faute d’opportunités de formation longue pour les jeunes cinéastes – le Mozambique est, sans aucun doute, le pays PALOP qui montre le plus grand dyna- misme aujourd’hui quant à la création documentaire.
L’une des raisons principales de ce phénomène sont les efforts faits localement au niveau de la diffusion culturelle des films, en particulier les divers festivals qui ont été créés ces dernières années.
Diffusion
Le Dockanema, festival international de cinéma docu- mentaire, a été créé en 2006 à Maputo par le producteur Pedro Pimenta, qui l’a dirigé jusqu’en 2011 et qui en est désormais le directeur artistique. Le festival organisé jusque là par sa société de production Ebano Multimé- dia, bénéficiant de la collaboration de l’Association Mo- zambicaine de Cinéastes (AMOCINE), est désormais produit par la branche mozambicaine de l’entreprise de production audiovisuelle brésilienne Cinevideo. Il présente à chaque édition autour de 80 films internation- aux, faisant la part belle à la production nationale dans sa section spécifique « O sal da terra ». Les objectifs du festival sont non seulement de donner au public mozam- bicain la possibilité de voir une programmation alterna- tive aux rares salles encore ouvertes dans la capitale, mais aussi de créer un espace de réflexion sur le secteur docu- mentaire national. A chaque édition sont ainsi organ- isés des colloques et réunions, rares occasions de réunir annuellement tous les acteurs locaux pour réfléchir sur les questions de la production, de la diffusion mais aussi de la formation. En 2011, le Dockanema a posé la pre- mière pierre de ce qui pourrait devenir une plateforme de coproduction : les cinéastes locaux ont eu l’occasion de rencontrer et de présenter leurs projets en cours à des producteurs ou responsables de programmes internation-aux lors d’entretiens individuels. Une grande importance est accordée aussi à la production documentaire des pays africains, et en particulier des pays lusophones.
Le festival a, depuis ses débuts, eu le souci de décen- traliser la manifestation en organisant des répliques plus réduites dans la ville septentrionale de Nampula, en collaboration avec l’Université locale, mais aussi d’impliquer des publics universitaires en organisant des projections régulières dans celles-ci . Des associations universitaires prennent ainsi le relais et se chargent d’ une programmation régulière .
Parallèlement à cette manifestation, d’autres associa- tions participent à la diffusion culturelle de la production nationale. Le forum Kugoma propose depuis 2010 un festival de courts-métrages international qui fait lui aussi une place importante aux productions mozambicaines. Le service culturel de la Faculté de Lettres et de Sciences Sociales de l’Université Eduardo Mondlane de Maputo propose chaque mois d’août, en prélude au Dockanema, un cycle de cinéma mozambicain. Organisant des col- loques thématiques liées à la politique culturelle et de diffusion du cinéma, l’événement joue aussi son rôle dans la revalorisation du patrimoine cinématographique et dans le débat national sur le devenir du secteur au Mo- zambique. Enfin, un festival de cinéma africain, Cinema Meu, est organisé à Inhambane par une ONG locale en partenariat avec Dockanema et réserve lui aussi 40% de sa programmation au cinéma mozambicain.
Ces initiatives individuelles pallient l’état catastroph- ique de la distribution et de l’exploitation au Mozam- bique. Comme dans la plupart des pays d’Afrique, les salles de cinéma ont petit à petit fermé. Des 120 salles des premières années de l’indépendance, il n’en reste plus que trois en fonctionnement régulier, qui n’exploitent que des films commerciaux américains ou portugais. Les salles informelles proposant des films piratés ou des séries de mauvaise qualité représentent la seule alternative aux salles de cinéma.
Enfin la diffusion télévision de la production documen- taire est quasiment nulle. Les films archivés à l’INAC et autres productions ne sont que très sporadiquement diffusés par la télévision nationale (TVM) et sans con- tre-partie économique. L’ exception s’est vérifiée une fois encore en partenariat avec le festival Dockanema quand la chaîne privée TIM (Televisao Independente de Mocambique) a diffusé pendant plusieurs semaines et avec succès auprès de son audience un ensemble de documentaires locaux.
Un projet d’établissement d’un réseau de salles nu- mériques destiné à la diffusion de produits audiovisuels est actuellement à l’ étude sous la direction de Pedro Pimenta. Il s’agit d’ établir un modèle de diffusion centré sur l’accès facilité par le numérique qui soit économiquement viable. L’ absence de structures de dif- fusion constitue dans ce cas une opportunité à exploiter.
Formation
Comme pour la diffusion, ces dernières années ont vu naître un certain nombre d’initiatives en termes de for- mation à l’audiovisuel et au documentaire en particuli- er. Cependant, ce ne sont pour l’instant que des forma- tions courtes et ponctuelles, souvent financées par les coopérations internationales. Il est par conséquent dif- ficile qu’en sortent des professionnels de l’audiovisuel : elles sont tout au mieux à même de susciter l’intérêt de nouveaux jeunes et de servir d’initiation.
En mars dernier a été organisée la seconde édition de l’atelier de création de cinéma documentaire « Regards pour le territoire ». Le projet, sous le patronage de l’ambassade d’Espagne à Maputo, est une initiative de l’association Kugoma en partenariat avec l’ONG espag- nole Audiovisuales sin Fronteras. Prévue sur une durée de quatre ans, il consiste en des ateliers annuels d’une durée d’une semaine au cours desquels une douzaine de participants ont l’occasion de réaliser un documentaire de création sur une thématique donnée, généralement liée à la ville de Maputo. Tout le matériel nécessaire à la réalisation est mis à disposition des participants, qui se spécialisent dans une fonction précise du processus d’élaboration d’un film : le cadrage, le son, la produc-tion, le montage, etc. Les organisateurs espèrent que l’atelier pourra avoir un impact à long terme, susci- tant réellement l’envie et apportant des connaissances basiques à des jeunes qui s’engageront dans des profes- sions liées à l’audiovisuel. Pour Koguma, il s’agit de palier l’inexistence de fonds nationaux, qu’ils soient publics ou privés, dédiés à la formation audiovisuelle.
Une formation plus approfondie, inscrite dans le cadre du Dockanema, avait été prise en charge par la société de production portugaise Terra Treme en 2009. Etalée sur six mois, elle a permis à de jeunes mozambicains motivés et témoignant d’un vrai désir de réalisation, de se sensibiliser au cinéma documentaire lors des nombreux visionnages de films internationaux dans le cadres des cours ; puis de mûrir, avec l’appui des formateurs, un projet de film véritablement personnel qu’ils ont finalement terminé à la fin de la formation. De cet atelier, cinq courts-métrages d’une étonnante qualité ont été réalisés et diffusés dans des festivals in- ternationaux. Cette idée de formation inscrite dans une durée plus longue est non seulement plus efficace quant à l’assimilation des contenus et techniques enseignés, mais aussi plus réaliste quant à la réalité matérielle des candidats, leur permettant de combiner la formation avec leur emploi.
Deux institutions d’ enseignement superieur , l’ Ecole de Communication et Art (ECA) de l’ Université Edu- ardo Mondlane et l’Institut Supérieur des Arts et de la Culture (ISArC) se proposent de développer un cursus universitaire en cinéma ou audiovisuel. Les ébauches de curriculum soumises à discussion ont été rejetées par la branche professionnelles étant calquées sur des modèles étrangers (Brésil et Portugal) donnant priorité à la théorie et étant peu adaptées aux besoins réels de développement du secteur.
PROGRAMMES INTERNATIONAUX DE SOUTIEN AU CINEMA
L’INITIATIVE DOC TV CPLP
Les Pays Africains de Langue Officielle Portugaise, comme nous l’avons déjà souligné, font partie de diverses organisations internationales, en particulier la Communauté des Pays de Langue Portugaise, qui inclut en plus des cinq PALOP, le Portugal, le Brésil et Timor Leste. Créée le 17 juin 1996, la CPLP a une personnalité juridique propre et est dotée d’une autonomie financière. Ses missions sont d’ordre diplomatique mais consistent aussi à encourager la coopération entre les pays membres, dans tous les domaines y compris la culture.
Le programme Doc TV CPLP, un programme d’encouragement à la production et la télédiffusion de documentaires des pays CPLP et Macau, est une initia- tive de la société Empresa Brasil de Comunicação/TV Brasil, du Secrétariat de l’Audiovisuel du Ministère de la Culture bresilien et de la Fondation Padre Anchieta/TV Cultura, également soutenue par l’Institut du Cinéma et de l’Audiovisuel portugais. En 2008, sa première édition a été approuvée à l’issue d’une réunion extraordinaire entre tous les ministères de la culture – ou les autorités équivalentes, et les télévisions publiques des pays par- ticipants. Le projet vise la systématisation des actions de réalisation, de production et de diffusion du docu- mentaire à partir d’un modèle en réseau grâce auquel, de manière simultanée, chaque pays participant coproduit un documentaire et chaque télévision publique s’engage à diffuser la série complète.
Le fonctionnement du programme est basé sur un appel à projet en ligne à l’issue duquel un projet par pays est sélectionné. Les projets doivent êtres inédits et accompagnés d’une société locale engagée dans la production du film, avec laquelle le Secrétariat Exécutif de la CPLP établit un contrat de financement et un contrat de cession de droits patrimoniaux régulant les conditions d’exploitation commerciale de chaque docu- mentaire. Le financement est de 50 000 euros pour la production de chaque œuvre qui doit être produite dans les six mois qui suivent la signature du contrat de financement. Au cours de la préparation, les réalisateurs sont tenus de participer aux rencontres de développe- ment de projet avec son producteur exécutif.
Le 1er programme Doc TV CPLP s’est déroulé au cours de l’année 2009 réunissant les participants à Ma- puto dans le cadre du festival Dockanema. Cinq films de 52’ ont été réalisés dans les PALOP10 puis diffusés sur les télévisions des neufs pays au cours de l’année 2010. La série a été également programmée au festival DocLisboa en 2011.
Ce programme de production et de diffusion en réseau est sans aucun doute un modèle à suivre, permettant la production de documentaire dans des pays où celle-ci est quasiment inexistante, et donnant un impact de dif- fusion qui dépasse les frontières nationales. Cependant, Doc TV CPLP semble difficile à soutenir sur le plan économique. La seconde édition du programme, dont le lancement avait été annoncé pour le début de l’année 2011, n’a pas encore vu le jour.
FESTIVALS CONSACRÉS À LA PROMOTION DU CINÉMA LUSOPHONE
Le FESTin – Festival de Cinéma Itinérant de Langue Portugaise a vu le jour en 2010, dans l’objectif de diffuser et fortifier la culture lusophone à travers le cinéma, dans un esprit de partage, d’échange et d’inclusion sociale. Organisé chaque année à Lisbonne, il propose une programmation annuelles de plus de 70 titres issus des pays de la CPLP, accompagnée d’ateliers et de tables rondes consacrés à la production filmique des pays membres de la CPLP. Le festival tend à dédier chaque édition à un pays spécifique et le cinéma ango- lais sera à l’honneur en 2013.
CONCLUSION
SOURCES
Ouvrages
BARLET Olivier, Les cinémas d’Afrique noire : le regard en question, Paris, 1996
CONVENTS, Guido, L’Afrique ? Quel Cinéma, Bruxelles, 2003
CONVENTS Guido, Os Moçambicanos perante o cinéma e o audiovisual, Maputo, 2011
DIAWARA, Manthia, African Film: New Forms of Aesthetics and Politics, Indiana University Press, Blue Montain, 2010
DUARTE DE CARVALLHO, Ruy, A câmara, a escrita e a coisa dita, Luanda, 1997
LELIEVRE, Samuel, Cinémas Africains : une oasis dans le désert, CinemAction nº106, Paris, 2003 MATOS-CRUZ, José, ABRANTES, José Mena, Caminhos do cinéma em Angola, 2002
DE MATOS, Patrícia Ferraz, As cores do império: Representações raciais no Império Colonial Português, Lisbonne, 2006
Articles journaux, revues et portails online
« Aprovada Lei do Cinema e Audiovisual », O Pais Online, 7/12/2011
« Associação para o Cinema e Audiovisual: Take 1 », ASemana, 1/3/2012
« Associação de Cinema e Audiovisual em Cabo Verde », Mário Vaz Almeida, Tempo de Lobos, 14/05/2012
« Cabo Verde sem uma única sala de cinema », Luis Cardador, BBC Para Africa.com, 8/11/2007
« Cineclube da Assomada: A sala com mais filmes do país », Sara Almeida, Expresso das Ilhas, 4/8/2012
« Cinema Angolano parte I. Experiências e perspectiv- as », Mariano Bartolomeu, O Pais Online, 3/3/2010
« Cinema Angolano parte II. Perspectivas para o futuro », Mariano Bartolomeu, O Pais Online, 3/3/2010
« Cinema em Moçambique. Se não se pode construir que se conserve a historia », Gil Filipe, Noticias, 29/1/2003
« Cinémas lusophones: le gâchis et l’espoir », Olivier Barlet, Africultures, 1/03/2000
« Cultura apela à produção de documentários », Fran- cisco Pedro, Jornal de Angola Online, 12/05/2010
« Documentário de Criação », Mário Vaz Almeida, Tempo de Lobos, 2011
« Fic Luanda 2009. Vencedores anunciados hoje », Vladimir Prata, O Pais Online, 27/11/2009
« Gui Ramos forma jovens em audiovisual numa parceria com a ADECO », Stevenn Silva, Nhaterra, 7/4/2010
« INAC : Criação e Progresso », Kuxa Kanema, Boletin de Cinema e Audiovisual em Moçambique, Maputo, juin 2009
« Instituto de Cinema e Audiovisual projecta um novo centro de produção », Jornal de Angola, Online, 15/04/2012
« Mário Bastos, temos novo realizador em Angola », Marta Lança, Buala Cultura Contemporânea, 3/11/2010
« O cinema da Guiné-Bissau », Filomena Embaló, Didinho, 10/3/2008
« O cinema Éden Park e a crise de exploração das salas de cinema », Adriano Miranda Lima, Islas de Cabo Verde, 13/05/2011
« Pedro Ramalhoso dá cara ao cinema », Jomo Fortu- nato, Jornal de Angola Online, 4/06/2012
« Quebrando o silêncio (II): Cinema Pobre », Matilde Era, Lantuna, Cabo Verde, 29/10/2006
« Sérgio Afonso, o rapaz da cámara fotográfica », Marta Lança, Austral nº 91, mai-juin 2012
« Silêncio (V): politica para o audiovisual », Matilde Era, Lantuna, Cabo Verde, 13/10/2006
« Une Afrique lusophone libérale ? La fin des Pre- mières Républiques », conférences de Michel Cahen, CNRS, IEP Bordeaux et GDR « Afrique Australe », Bissau, 21/11/1993 & Bordeaux, 10/05/1995
Rapports
AfroCine : Transcription de la Conférence de Ondjaki au festival Afrocine, Paula Faccini de Bastos Cruz, Laboratoire d’Etudes Africaines, Institut d’Histoire de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ), 21/11/2011
Anais do XV encontro régional de Historia da Anpuh- Rio, Oficio do Historiador/Ensina & Pesquisa, São Gonçalo, 23 et 27 juillet 2012
Apresentação I Programa DOCTV CPLP, Ministère de la Culture – Instituto du Cinema et de l’Audiovisual (ICA), Lisbonne, 14 e 15 Novembre 2008
Convênio 752945, Órgão 20408 : Fundação Cultural Palmares, Governo Federal, SICONV, Gouvernement Fédéral du Brésil, 26/1/2011
Perspectives économiques en Afrique 2011 – L’Afrique et ses partenaires émergeants, OCDE, PNUD, Groupe de la Banque Africaine de Développement, ACP, Commission Economique pour l’Afrique, Editions OCDE, 6 juin 2011
Perspectives économiques en Afrique 2012 – Promou- voir l’emploi des jeunes, OCDE, PNUD, Groupe de la Banque Africaine de Développement, ACP, Commis- sion Economique pour l’Afrique, Editions OCDE, 28 mai 2012
Projecto de lei do cinema, Ministère de la Culture, Angola, Luanda, Mars 2010
PLEI – Cultura. Plano Estratégico Intersectorial da Cultura, Ministerère de la Culture Cabo Verde, non daté
Une Afrique lusophone libérale ? La fin des Premières Républiques
Sources audiovisuelles
« Cinema e audiovisual em Cabo Verde », programme Conversa em Dia, RTCV, 31 mai 2012
« Arranca, na ilha do Sal, Festival Internacional de Cinema, promovido pela Viva Imagem », Journal TV, RTCV, 16/10/2010
Sites web
www.ficluanda.org/ www.angoladigital.net/cultura www.opais.net/pt www.africultures.com www.buala.org www.culturamovel.cv www.rtc.cv
www.tempodelobos.blogspot.com.es www.instituto-camoes.pt/centros-culturais/africa/ centro-cultural-portugues-na-praia
www.cviff.org www.tpa.sapo.ao www.tvm.co.mz www.lxfilmes.com www.marfilmes.com
Contacts
Pedro Ramalhoso (Directeur IACAM, Angola) Zeze Gamboa (Realisateur, Angola)
Gita Cerveira (Technicien , Angola) Joel Zito Araújo (Réalisateur, Brésil)
Mário Vaz Almeida (Réalisateur, Cap-Vert) Julio Silvao Tavares (Producteur -Realisateur, Cap-Vert)
Pedro Pimenta (Producteur, Mozambique) Renée Gagnon (Distributrice, Portugal)
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.